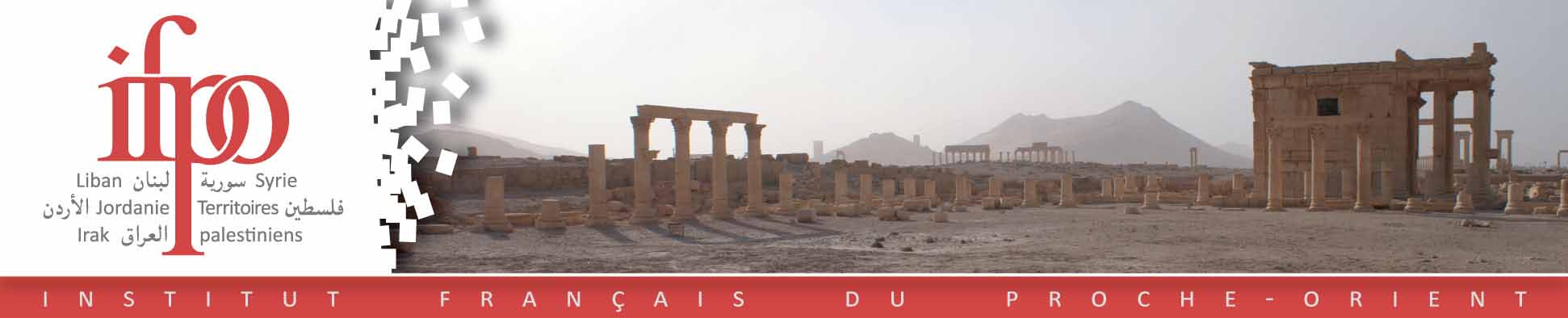WADI – Webinaires Académiques des Doctorant·e·s de l’Ifpo
Un wadi est une vallée dans une région semi-désertique, mais c’est aussi les rendez-vous des doctorant·e·s de l’Institut français du Proche-Orient. Un jeudi sur trois, un·e intervenant·e est invité·e à présenter ses travaux lors d’une séance de webinaire problématisée autour d’un questionnement méthodologique ou d’une thématique scientifique.
Ces rencontres doctorales ont pour objectif d’accompagner les recherches de thèse, tout en observant une approche pluridisciplinaire qui ouvre sur le paysage élargi des sciences humaines et sociales. Les WADI sont aussi l’occasion d’échanger entre les différentes antennes de l’Ifpo et de faire dialoguer leurs contextes politiques et géographiques.
Certaines séances sont consacrées à la présentation de l’avancée des recherches des doctorant·es, d’autres à la présentation de travaux de chercheur·euse·s mettant en avant des thèmes ayant trait à la région, à des problématiques la concernant ou encore à la méthodologie de la recherche. Des séances autour de l’environnement numérique sont également proposées.
Les WADI sont ouverts aux doctorant·e·s associé·e·s et aux chercheur·euse·s de l’Ifpo.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Elsa Maarawi.
L’archive des séances de l’année 2020-2021 est disponible sur cette page.
Séance du 21 juillet 2022 : La protection des données des enquêté·es et les questions d’éthique
Une séance avec Yves Mirman (Université Catholique de Lyon, Mésopolhis), organisée par Maena Berger (EHESS/CESSP) et Livia Perosino (SciencePo Bordeaux/LAM)
Au cours de cette séance, Yves Mirman nous a présenté un ouvrage collectif qu’il a co-dirigé, paru en janvier 2022 portant sur le régime de surveillance de la recherche en sciences sociales, que ce soit dans des États dits autoritaires ou dits démocratiques. (L’enquête en danger : https://journals.openedition.org/lectures/54156) Il a mentionné également les injonctions éthiques contradictoires qui concernent surtout la protection des institutions et la juridicisation de la recherche. Une discussion sur le rapport aux enquêté-es, à la définition de l’éthique en lien avec les lois RGPD a ensuite suvi.
Séance du 2 juin 2022 : Enquêter sur les productions artistiques au Liban : enjeux méthodologiques et écritures alternatives
Une séance avec et organisée par Fanny Arnulf (ULB/CEVIPOL-OMAM; Ifpo) et Charlotte Schwarzinger (EHESS/CéSor; Ifpo)
En résonance avec la dernière séance, nous aborderons nos entrées sur le terrain et les difficultés que nous avons rencontrées. Plus particulièrement, nous nous arrêterons sur les enjeux de la recherche ethnographique dans la période de crise que connait le Liban aujourd’hui.
Ce contexte particulier nous a amené à penser à des méthodes alternatives de recherche. C’est pourquoi nous partageons avec vous nos réflexions autour de l’écriture filmique. Dans ce cadre Charlotte abordera la mise en place de son projet de fiction collaboratif et Fanny présentera son projet de film documentaire.
Séance du 19 mai 2022 : Relation ethnographique
Une séance avec et organisée par Laura Chaudiron (Paris 1/CESSP; Ifpo) et Akhésa Moummi (EHESS/LIER-FYT;CéSor;Ifpo)
Pour cette séance, nous nous proposons de remettre sur le métier les pratiques ethnographiques, en réfléchissant collectivement à la façon dont nous sommes entrées sur nos terrains respectifs, puis dont nous y avons négocié une installation plus ou moins durable.
Nous nous proposons de croiser ces expériences avec différentes lectures méthodologiques ayant constitué pour nous de précieuses ressources. En particulier, nous réfléchissons à la manière dont le chercheur peut être progressivement “adopté” par son terrain, se trouvant ainsi forcé de naviguer dans des réseaux d’interconnaissance et de pouvoir. La question de la temporalité est interrogée à cette occasion.
Séance du 28 avril 2022 : Approches multisituées
Une séance avec Julien Brachet (Paris 1/IRD et membre de l’Institute for Advanced Study de Princeton), organisée par Elsa Maarawi (UPJV/CURAPP-ESS ; Ifpo)
Comment cette méthodologie s’est-elle développée dans les sciences sociales ? Quels en sont les apports et les limites ? S’appuyant sur ses propres travaux portant sur la mobilité dans la région du Sahara-Sahel, Julien Brachet questionne les manières dont cette méthodologie peut s’intégrer dans différents projets de recherche, notamment sur et au Proche-Orient. Il évoque également comment le multi-situé pose la question de la positionnalité et de la réflexivité d’une manière spécifique.
Quelques références bibliographiques à consulter : l’article de Julien Brachet : https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2012-5-page-543.htm et l’article fondateur de G. Marcus « Ethnography in/of the world system : The Emergence of Multi-Sited Ethnography » dont voici le lien : https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.an.24.100195.000523
Séance du 7 avril : Les catégories occidentales appliquées à la recherche au Proche-Orient
Une séance avec Myriam Catusse (directrice de l’Ifpo et chercheuse au CNRS) organisée par Livia Perosino (SciencePo Bordeaux/LAM)
Cette séance discute l’application de catégories occidentales dans la recherche sur les pays du monde arabe. Il s’agit ici de se questionner sur son propre positionnement et sur la légitimité de concepts qui ont « voyagé » entre pays. Nous pouvons également nous interroger sur les termes mêmes à employer : Nord-Sud ? Pays développés, en voie de développement et sous-développés ? Pays de la majorité et de la minorité du monde ?
Séance du 17 mars : Les questions de genre sur le terrain
Une séance avec Marielle Debos (Paris Nanterre, membre de l’Institute for Advanced Study de Princeton) organisée par Camille Abescat (SciencePo Paris/CERI) et Maena Berger (EHESS/CESSP)
À quelles difficultés particulières peut-on faire face lors de l’enquête quand on est une femme ou minorité de genre ? Comment se protéger contre les violences sexistes et sexuelles et les appréhender d’un point de vue méthodologique et scientifique ?
A travers ses propres travaux portant sur les armes comme mode de contestation ordinaire et comme façon de vivre, pendant cette séance, Marielle Debos discute la question du genre, sous l’angle de l’accès et l’accessibilité au terrain. Elle a traité quatre questions principales : Y a-t-il des terrains inaccessibles? Toutes les recherches méritent-elles d’être menées? Qu’implique travailler sur la guerre en tant femme? Les questions éthiques dans la recherche sur un terrain étranger.
Voici quelques références citées pendant la séance :
Giulia PICCOLINO et Sabine FRANKLIN, « The Unintended Consequences of Risk Assessment Regimes: How Risk Adversity at European Universities Is Affecting African Studies », Africa Spectrum, Volume 54 Issue 3, December 2019, URL : https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0002039719898904
Julien BRACHET et Judith SCHEELE, The Value of Disorder. Autonomy, Prosperity, and Plunder in the Chadian Sahara, Cambridge University Press, May 2019, URL : https://www.cambridge.org/core/books/value-of-disorder/8A8885D539E1ADEF56BE67E4BD80A2EB
Marsha HENRY, « Ten Reasons Not To Write Your Master’s Dissertation on Sexual Violence in War », post in The Disorder of Things, June 4th 2013, URL : https://thedisorderofthings.com/2013/06/04/ten-reasons-not-to-write-your-masters-dissertation-on-sexual-violence-in-war/
Millie LAKE, Strong NGOs and Weak States. Pursuing Gender Justice in the Democratic Republic of Congo and South Africa, Cambridge University Press, May 2018, URL : https://www.cambridge.org/core/books/strong-ngos-and-weak-states/2880FAC0349E13A04946C20FA0007361
Marielle DEBOS, Living by the Gun in Chad: Combatants, Impunity and State Formation, Zed Books, 2016, URL : https://www.abebooks.com/9781783605323/Living-Gun-Chad-Combatants-Impunity-1783605324/plp
Carli Coetzee, « Ethical?! Collaboration?! Keywords for our contradictory times », Journal of African cultural Studies, Vol 31, Issue 3, 2019, URL : https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13696815.2019.1635437
Séance du 24 février 2022 : Présentation de travaux de thèse
Une séance organisée par Clémence Vendryes, Petra Samaha et Elsa Maarawi
Cette séance est l’occasion pour trois doctorantes de parler de leurs travaux de recherche respectifs. En présentant leurs réflexions en cours, le but est d’initier une discussion interdisciplinaire avec les participant·e·s. En mettant leur terrain et leur démarche en contrepoint les unes des autres, elles souhaitent déplier la question des rapports sociaux à travers des espaces, théoriquement et géographiquement différents.
Clémence Vendryes est doctorante AMI à l’Ifpo TP, inscrite à l’Université d’Aix-Marseille (IREMAM) en géographie et travaille sur la place des cimetières dans la ville de Jérusalem et en Cisjordanie, Elsa Maarawi est doctorante associée à l’Ifpo Beyrouth, inscrite à l’Université de Picardie Jules Verne (CURAPP-ESS) en sociologie et sa recherche porte sur les reconfigurations des rapports sociaux de sexe dans les migrations syriennes au Liban et en France, et Petra Samaha, doctorante associée à l’Ifpo Beyrouth, inscrite à SciencePo Paris (CERI) en sociologie, s’intéresse à la relation entre citoyens et espace publics au Liban à travers la question de la propriété foncière.
Séance du 27 janvier 2022 : Organisation du travail et réseaux clientélaires à Beyrouth
Une séance avec Michele Scala (Science Po Lyon/CeSSRA; Ifpo), organisée par Mariette Ballon (Lyon 2/Triangle; Ifpo) et Emmanuelle Durand (EHESS/Iris; Ifpo)
Cette présentation est issue de la thèse « Le clientélisme au travail. Une sociologie de l’arrangement et du conflit dans le Liban contemporain (2012-2017) », sous la direction de Richard Jacquemond (IREMAM/Université Aix-Marseille (AMU) et Myriam Catusse (IREMAM/CNRS), soutenue à l’ Université d’Aix-Marseille en 2020. S’appuyant sur une enquête ethnographique de 2012 à 2017 à Beyrouth au sein de l’ entreprise Spinneys et l’institution publique Electricité du Liban, la recherche de Michele Scala sur les mobilisations de travailleurs dans ces deux établissements l’a amené à étudier les réseaux clientélaires propres à l’organisation du travail à Beyrouth.
Séance du 6 janvier 2022 : La place de l’histoire dans les méthodologies de recherche en sciences sociales au Moyen-Orient.
Une séance avec Matthieu Rey (Ifpo), organisée par Elsa Maarawi (UPJV/CURAPP-ESS; Ifpo)
La présentation tente de dresser quelques grands lignes et défis autour des sources pour approcher un objet de recherche au Moyen-Orient, en l’historicisant. Historiciser un objet suppose de réfléchir aux notions et concepts utilisés, renvoyant une nouvelle fois aux interrogations portant sur les termes endogènes (assabiyya) et exogènes (Etat non dawla). En outre, la pratique historienne implique l’adoption d’autres modes de travail et une autre façon de voir la documentation – le terrain – au prisme de ce que nous pouvons détecter du passé pour un objet.
L’idée première est de réfléchir à ce que veut dire une prise en considération de temporalités et de séquences pour saisir le passé d’un présent. Naturellement, chaque objet et surtout chaque problématique adressée à cet objet cadre l’espace temporel considéré. A titre d’exemple, l’intervenant s’appuie principalement sur l’histoire syrienne contemporaine.
Séance du 16 décembre 2021 : Les enjeux de l’enquête en situation de crise
Une séance avec et organisée par Akhésa Moummi (EHESS/LIER-FYT;CéSor/Ifpo)
En partant de situations concrètes rencontrées sur nos différents terrains, Akhésa Moummi ouvre un espace d’échange autour des effets de la « crise » sur la production de la recherche. En partant de l’expérience de sa recherche sur les écoles de la Mission Laïque au Liban, elle présente les difficultés liées à son terrain et à sa position de chercheuse dans ce contexte incertain.
Séance du 25 novembre 2021 : Faire du terrain auprès d’institutions internationales
Une séance avec Marion Frésia (UniNE/IETHNO), organisée par Solenn Al Majali (TELEMMe/ CNRS Ithaca) et Lyla André (UCLouvain/ISPOLE, GERMAC; Ifpo)
Marion Fresia nous invite à une démarche réflexive autour de la posture de chercheur(e) en sciences sociales au sein d’une institution internationale. S’appuyant sur sa propre expérience dans le champ de la bureaucratie transnationale de l’asile, sa présentation porte sur l’étude des rapports ambivalents entre le HCR et les milieux académiques et traite des aspects méthodologiques, éthiques et épistémologiques liés à l’enquête de terrain dans les institutions internationales.
Référence : Ouvrage collectif publié en 2018 chez Karthala et co-édité par Marion Fresia et Philippe Lavigne Delville, Au cœur des mondes de l’aide internationale. Regards et postures ethnographiques qui propose une réflexion sur l’aide internationale, ses institutions, ses pratiques et ses effets.
Séance du 14 octobre 2021 : Formation au logiciel Zotero
Une séance avec Taos Babour (Ifpo), organisée par Héloïse Peaucelle (Université de Tours/Citeres)
Formation au logiciel Zotero, introduction aux fonctions de bases et exercices pratiques en ligne.