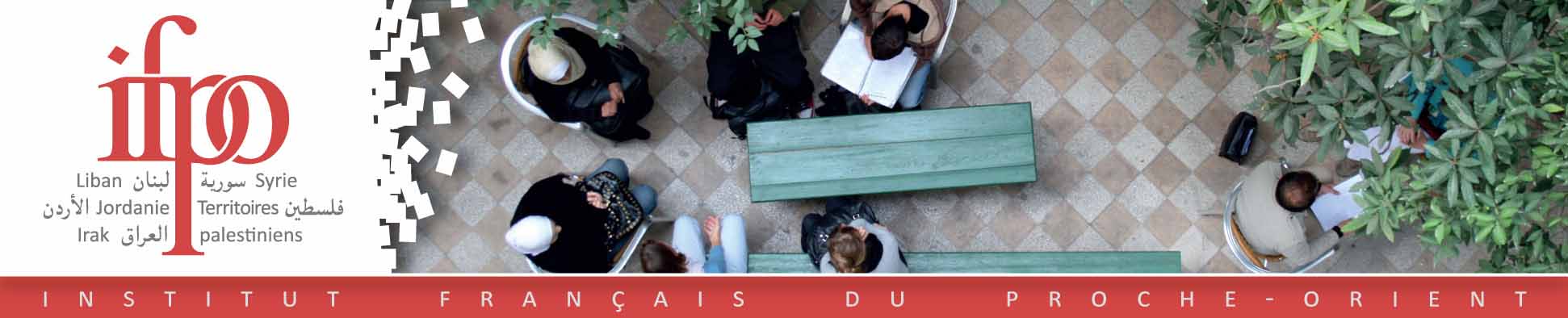Mission archéologique d’Amyan (MAA)
Le site d’Amyan se situe au cœur de la plaine de Navkur, au sud d’Akre (gouvernorat de Dohuk), à une quarantaine de kilomètres à vol d’oiseau au nord-est de l’antique Ninive. Cette plaine montre une densité de sites exceptionnelle et une occupation presque continue depuis le VIe millénaire av. J.-C. Les prospections effectuées ont recensé plus de 400 sites dans cette région extrêmement fertile, traversée par une multitude de ruisseaux et des rivières dont la plus importante, Al Khazir, se jette dans le Grand Zab. D’une largeur approximative de 30 km, cette plaine est délimitée au nord par les contreforts de Zagros, au sud par les monts Jebel Maqlub et Bardarash, à l’ouest par la plaine d’Al Qosh et par le lac moderne de Mossoul, et à l’est par le grand Zab.
Le site d’Amyan est composé d’une ville haute de forme ovoïde, orientée NE-SO, mesurant approximativement 4 hectares pour une hauteur maximale de 26 mètres au-dessus de la plaine. La ville basse, d’une quinzaine d’hectares, est aujourd’hui en partie recouverte par un village moderne, établi dans les années 70. Au pied de la ville haute, sur son côté ouest, passe la rivière Kurabak, affluent de la rivière Al Khazir.
Le site est entouré d’une dizaine de petites occupations périphériques, réparties sur une surface d’une centaine d’hectares. Le ramassage de surface effectué sur le site a mis en évidence une occupation au cours des périodes suivantes : Chalcolithique tardif (4500-3000 av. J.-C.), Ninivite 5 (3000-2500 av. J.-C.), deuxième moitié du IIIe millénaire (2500-2000 av. J.-C.), Bronze moyen (2000-1600 av. J.-C.), Mitanni (1600-1300 av. J.-C.), médio-assyrien (1300-1000 av. J.-C.), néo-assyrien (1000-600 av. J.-C.), post-assyrien et hellénistique (600-125 av. J.-C.), parthe (125 av. J.-C.-150 ap. J.-C.) et islamique récent et moyen (650-1300). Les périodes les plus représentées sur le site sont l’âge du Bronze ancien et du Bronze moyen (IIIe et IIe millénaires av. J.-C.).

Amyan, vue de la ville haute et de la ville basse, partiellement recouverte par un village moderne, depuis le nord-ouest (LoNAP, 2018)
Créée en 2019, la Mission archéologique d’Amyan a pour objectif principal une meilleure connaissance de l’histoire de la région nord de la Mésopotamie — située dans l’actuel Kurdistan irakien — dans l’Antiquité, plus particulièrement au cours de l’âge du Bronze ancien (IIIe millénaire av. J.-C.). Les trois axes de recherche principaux sont :
- révéler la séquence chronologique complète de l’occupation du site et établir un référentiel typologique céramique ;
- étudier les niveaux de l’âge du Bronze ancien (IIIe millénaire av. J.-C.) ;
- étudier l’environnement du site.
La première campagne de fouilles, réalisée au printemps 2019, s’est voulue une campagne exploratoire permettant de jauger du potentiel du site sur trois volets : une mission topographique qui a permis une première reconnaissance du site, l’établissement d’un plan topographique, de bornes topographiques et une documentation photogrammétrique des zones fragiles sujettes à la destruction par érosion ; l’exploitation archéologique d’une tranchée en escalier sur le flanc du tell ; l’étude du matériel issu des fouilles.
Les fouilles archéologiques avaient pour objectif d’explorer les différents niveaux de la ville haute afin d’avoir une vision d’ensemble de la chronologie de l’occupation du site. Pour cette raison, une tranchée de 32 mètres de long et de 3 mètres de large, orientée E-O, a été ouverte. Cette tranchée (secteur A) a été divisée en trois chantiers de 10 mètres de long, séparés par deux bermes de 1 mètre de large.
Les résultats de cette première campagne ont suscité un vif intérêt et ont clairement confirmé l’importance d’Amyan comme étant l’une des principales villes de la plaine, contrôlant probablement la route menant de Ninive vers l’arrière-pays, au nord-est. En effet, la tranchée n’a pas révélé une succession d’occupation, mais une structure massive, résultant d’un urbanisme planifié : un mur, probablement un mur d’enceinte (rempart ?) dans le chantier A2. Ce mur, d’une largeur de 3,60 mètres, est conservé sur une hauteur de 2,60 mètres. Il est orienté N-S, légèrement désaxé par rapport à l’E. Il a été construit avec des briques crues carrées (36 x 36 x 12 cm) et des demi-briques (18 x 36 x 12 cm). Les joints entre les briques sont très nets et mesurent environ 4 centimètres. Il est peu probable que ce mur appartienne à un bâtiment, car les couches archéologiques mises au jour contre lui, à l’intérieur, ont livré un certain nombre d’ossements d’animaux et présentent un pendage parallèle à celui de la pente, ce qui semble mettre en évidence un contexte extérieur.
Ce mur repose sur une structure massive, soit un glacis, soit une terrasse, dégagé dans le chantier A3. Orienté N-S, cette structure est composée de briques carrées (40 x 40 cm). Ces briques se caractérisent par leur mauvais état de conservation et leur consistance très hétérogène. Il semble qu’aucune attention n’ait été portée à la face extérieure de cette masse, contrairement aux briques à l’intérieur du noyau de la masse, plus pures et compactes. Malheureusement, faute de temps, sa largeur totale n’a pas été démontrée, mais dans les limites du chantier, la largeur minimale dégagée est de presque 4 m, pour une hauteur de 3 m environ.
Un peu au-dessus du mur dégagé dans le chantier A2 se trouve un bâtiment duquel un seul mur et une partie d’une cour ont été dégagés, dans le chantier A1, reposant sur une épaisse couche de terre homogène qui pourrait résulter d’un nivellement. Une phase postérieure a également été découverte, très mal conservée. Ce bâtiment, bien que dégagé à une altitude supérieure au mur d’enceinte, pourrait appartenir à la même phase, si l’on en croit la similitude du matériel récolté et la nature des sédiments dégagés. Il s’agirait donc, au moins sur cette région de la ville haute, d’une architecture planifiée, sur plusieurs niveaux.
L’étude de la poterie sur le terrain pendant la campagne de fouilles a impliqué une quantification prenant en compte les fragments diagnostiques, ainsi que les groupes céramiques et le décor. Si une analyse plus précise doit maintenant être réalisée pour permettre l’établissement d’une typo-chronologie, certains éléments importants ont déjà émergé. La vaisselle fine est représentée par de très nombreux fragments diagnostiques, courants dans les assemblages néo et post-assyriens de la région. La vaisselle mi-fine est représentative des assemblages datant de l’âge du Bronze moyen et récent. La céramique de cuisson est, jusqu’à présent, exclusivement représentes par des fragments de marmite. Certains fragments de bord et de base peuvent être comparés aux exemples médio-assyriens connus par ailleurs. La difficulté principale au sujet de l’étude céramique est relative aux contextes dégagés : de l’architecture monumentale et trop peu de sols et de contextes clos.
L’étude des objets, toujours en cours, a également révélé quelques découvertes intéressantes, parmi lesquelles une collection de clous en terre cuite, souvent utilisés fichés dans des murs, certains avec une section quadrangulaire. Datant probablement de la fin du IIe millénaire av. J.-C. ou de la période néo-assyrienne, ces clous sont caractéristiques de l’ornementation d’architecture monumentale, qu’il s’agisse de temples, palais ou portes monumentales. Il faut également mentionner, toujours hors contexte, deux pointes de flèche en métal, des figurines animales et une quantité très importante de scories, en terre cuite pour la plupart. Ces scories ont été découvertes dans tous les chantiers de la tranchée, attestant la présence d’un atelier dans les environs. Ainsi, la culture matérielle assure, par la présence de ses clous, dont certains types sont morphologiquement inédits, l’importance de cette architecture que seul un pouvoir fort pouvait mettre en place dans un lieu hautement stratégique. Amyan était donc bien un des centres urbains les plus importants de la plaine au cours du IIe millénaire et certainement au début du Ier, si ce n’est déjà au IIIe.
Bibliographie
– À paraître. Couturaud B., « La Mésopotamie du Nord et le pays de Ninive : nouvelles recherches à Amyan », Syria 98, 2021.
– 2020. Couturaud B. (dir.), Archaeological Expedition in Amyan I. Report of the First Campaign (2019). [en ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02610503/document
– 2019. Couturaud B., « Retour de terrain, Amyan 2019. Première mission de recherche sur un site de la plaine d’Akre (Kurdistan irakien) », Les Carnets de l’Ifpo. La recherche en train de se faire à l’Institut français du Proche-Orient, 04/12/2019. [en ligne ] https://ifpo.hypotheses.org/9643
Sur le web et les réseaux sociaux
Retrouvez Amyan sur Patrimoine du Proche-Orient
Suivez la mission sur Facebook
Équipe
– Lorraine ABU AZIZEH, topographe (indépendante).
– Narmin ALI AMIN, archéologue (université Salahaddin-Erbil).
– Soizik BECHETOILLE, architecte (Institut français du Proche-Orient).
– Laurent COLONNA D’ISTRIA, épigraphiste et archéologue (université de Liège).
– Barbara COUTURAUD, archéologue et directrice de la mission (Institut français du Proche-Orient).
– Bekas HASSAN, archéologue (Direction des Antiquités d’Akre).
– Georges MOUAMMAR, céramologue (Archéorient UMR 5133).
– Ali OTHMAN, dessinateur (indépendant).
– Morgane PIQUE, historienne et archéologue (université de Lille).
– Omar SHAREF, archéologue (Direction des Antiquités d’Akre).
Partenariats et financements
La mission archéologique d’Amyan bénéficie du soutien de la Direction générale des Antiquités du Kurdistan et l’antenne de la Direction des Antiquités d’Akre, l’Institut français du Proche-Orient, la Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le Scac de l’ambassade de France à Bagdad, le consulat général de France à Erbil, l’université de Liège, l’université de Salahaddin-Erbil et l’université de Lille.